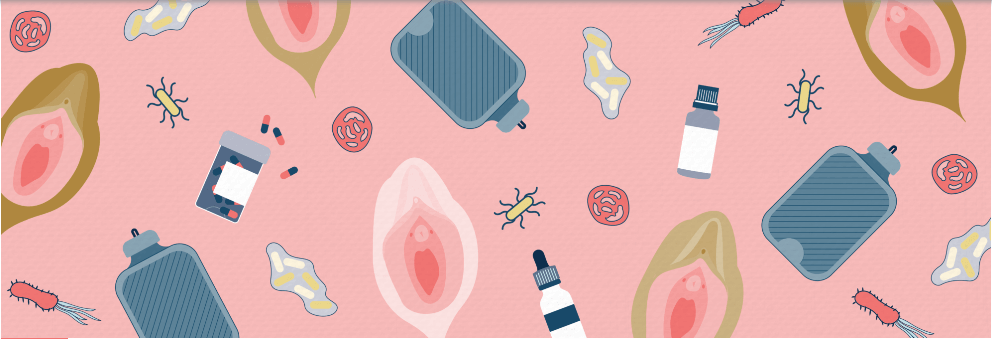Comme beaucoup de personnes, vous n’avez probablement jamais entendu parler des glandes de Skene. Pourtant, les glandes de Skene, situées autour de l’urètre, sont souvent désignées comme la « prostate féminine ». Elles permettent l’éjaculation féminine. Celle-ci pourrait être un mécanisme de défense évolutif, visant à protéger le corps des infections urinaires.
Les glandes de Skene peuvent s’infecter ou être inflammatoires. Dans ces deux cas on parle de skénite. La skénite peut causer des symptômes dans l’appareil urinaire semblables à ceux d’une infection urinaire. Les abcès et kystes au sein des glandes de Skene peuvent également déclencher de tels symptômes. Cependant, il est rare qu’une skénite soit détectée ou diagnostiquée correctement.
Alors, comment savoir si une infection des glandes de Skene est une cause potentielle de symptômes d’infection urinaire chronique ou récurrente ? Tout d’abord, observons l’anatomie de ces glandes, petites, mais d’une grande importance.
Raccourcis
- Les glandes de Skene, qu’est-ce que c’est ? >>>>
- La skénite : une inflammation des glandes de Skene >>>>
- Skénite et syndrome urétral >>>>
- Skénite et vulvodynie >>>>
- Traitement de la skénite >>>>
Les glandes de Skene, qu’est-ce que c’est ?
Les glandes de Skene, aussi appelées glandes vestibulaires mineures ou glandes para-urétrales/péri-urétrales, sont deux glandes de la taille d’un grain de maïs chacune. Leurs orifices ont la même épaisseur qu’une épingle.
Où se trouvent les glandes de Skene ?
Les glandes de Skene sont situées de part et d’autre de l’urètre. On s’accorde à les qualifier de prostate féminine du fait de leur proximité avec l’urètre et de la sécrétion de l’éjaculat féminin.
Les orifices externes des glandes de Skene sont présents d’un côté ou de l’autre de l’extrémité inférieure de l’urètre, à l’intérieur du vestibule. Le vestibule est la zone triangulaire située entre les petites lèvres et le clitoris. Cette partie comprend les orifices urétraux et vaginaux.
En interne, les glandes de Skene entourent l’urètre à peu près de la même manière que la prostate le fait chez les hommes. L’éjaculat féminin est expulsé par les orifices des glandes de Skene jusque dans le vestibule.
A quoi servent les glandes de Skene ?
Pourquoi les glandes de Skene font-elles partie de l’anatomie féminine ? Une théorie suggère que le tissu glandulaire et sa capacité à sécréter des fluides se développent pendant la phase embryonnaire, avant que la différenciation sexuelle ne se produise.
Et donc, la prostate féminine existe peut-être pour la même raison que les tétons masculins existent : elle se forme avant même que l’embryon ne développe un système reproducteur spécifiquement mâle ou femelle.
Cependant, les hypothèses de quelques scientifiques laissent à penser que les glandes de Skene auraient un but évolutif : la production de l’éjaculat féminin qui lubrifie l’orifice de l’urètre. L’éjaculat féminin contient des substances antimicrobiennes qui contribuent à éviter les infections urinaires.
Comme l’activité sexuelle peut être une cause d’infections urinaires, certains chercheurs avancent la possibilité que l’éjaculation féminine puisse faire partie du système de défense naturelle du corps.
Il est possible que les glandes de Skene jouent un rôle évolutif crucial. Selon cette théorie, les femmes qui ont moins de risques de contracter une infection urinaire après un rapport ont plus de chances d’avoir des rapports sexuels fréquents. Cela signifie qu’elles ont plus de chances de tomber enceinte et donc de transmettre leurs gènes.
Ce que l’on sait sur l’éjaculation féminine
L’éjaculat féminin correspond à une cuillère à café de liquide. Il peut être sécrétée avant, pendant ou après un orgasme et implique souvent une stimulation du point G. L’éjaculat féminin ressemble à un mélange de lait et d’eau. Il a un arôme sucré et son goût et son odeur sont similaires à l’urine.
D’un point de vue chimique, l’éjaculat féminin contient de grandes quantités d’acide prostatique, de phosphatase, d’antigène spécifique prostatique (ASP), de glucose et de fructose. Il comporte aussi de faibles quantités d’urée et de créatinine.
En d’autres termes, la présence de toutes ces précieuses substances nous indique qu’il est semblable à l’éjaculat masculin, à l’exception du sperme. L’éjaculat féminin était célébré dans beaucoup de cultures anciennes et des auteurs comme Aristote et Galien ont écrit sur le sujet.
Contrairement à la croyance populaire, l’éjaculation féminine et le « squirting » sont deux choses bien différentes. Le squirting qualifie la décharge soudaine et souvent puissante d’un liquide clair, souvent due à une stimulation du point G. Il est souvent représenté dans des films pornographiques.
Bien que ce liquide soit resté assez mystérieux pendant quelque temps, les recherches ont démontré que le squirting implique en fait de l’urine ainsi que des petites quantités de sécrétions prostatiques.
Dans une étude sur le squirting, on a d’abord demandé aux sujets de sexe féminin d’uriner avant de leur faire une échographie, pour constater que leurs vessies étaient vides.
Ensuite, les sujets ont fait l’objet d’une stimulation sexuelle jusqu’à ce qu’ils se retrouvent sur le point de squirter. A ce moment-là, on leur a fait une deuxième échographie qui a révélé que leur vessie s’était soudainement remplie.
La stimulation sexuelle a continué jusqu’à ce que les sujets se mettent à squirter. Enfin, on leur a fait une troisième échographie qui a montré que leur vessie s’était à nouveau vidée.
Il faut savoir que même si l’éjaculation féminine et/ou le squirting existent, certaines personnes en feront l’expérience et d’autres non. Ces réactions du corps ne sont pas représentatives de l’expérience de chacun·e en termes de stimulation ou d’orgasmes. De plus, environ un tiers des personnes dotées d’un sexe féminin ne possèdent aucune glande de Skene.
La skénite : inflammation des glandes de Skene
La skénite renvoie à une inflammation des glandes de Skene, qui les rend gonflées et douloureuses. Cette inflammation est généralement causée par des infections liées à des bactéries comme la gonorrhée ou l’e.coli, ou d’autres bactéries composant la flore vaginale et des formes variées de coliformes. La gonorrhée est particulièrement connue pour causer des skénites.
Une skénite peut apparaître en même temps qu’une infection urinaire, ce qui rend le traitement encore plus compliqué. Nous allons parler plus en détail du lien entre les glandes de Skene et les infections urinaires récurrentes dans cet article.
Des skénites récurrentes peuvent entraîner des abcès, c’est-à-dire une accumulation de pus à l’intérieur de la glande. La présence d’un abcès est déterminée par un examen médical et grâce à des images obtenues par IRM ou par échographie transpérinéale.
Complication de la skénite
Si la skénite reste non traitée, la pression exercée par l’abcès peut rompre les tissus, séparant alors la glande de Skene de l’urètre et causer un diverticule urétrale. Un diverticule urétral est une poche qui se développe n’importe où le long de l’urètre et qui se remplit répétitivement d’urine. Dans ce cas de figure, la poche en question est la glande de Skene.
Sinon, le pus de l’abcès peut se solidifier pour former un kyste de la taille d’une petite perle avec, à l’intérieur, une substance comparable au lait. Les kystes peuvent être retirés grâce à une opération chirurgicale. Les abcès des glandes de Skene sont plus fréquents chez les trentenaires et quarantenaires. Elles peuvent être causées par du diabète, une grossesse, un traumatisme physique dans cette zone et des antécédents d’une maladie de la peau appelée impétigo.
La skénite peut aussi être causée par des masses vaginales ou vulvaires à l’origine de lésions des glandes de Skene. La plupart du temps, ces masses sont retirées par une opération chirurgicale.
Tout comme la prostate masculine, les glandes de Skene peuvent développer des adénomes, c’est-à-dire des tumeurs glandulaires bénignes. Des adénocarcinomes, tumeurs glandulaires malignes, peuvent également apparaître. Cependant, le cancer des glandes de Skene est moins fréquent que celui de la prostate.
Symptômes de la skénite
Comme c’est le cas pour beaucoup de maladies urogénitales, les symptômes de la skénite peuvent se cumuler à d’autres diagnostics, dont celui de l’infection urinaire, de l’infection vaginale et de l’endométriose. Gardez donc à l’esprit que le fait de souffrir d’un ou plusieurs des symptômes suivants n’indique pas nécessairement un trouble des glandes de Skene.
- Infections urinaires récurrentes
- Douleur sus-pubienne (douleur derrière ou près de l’os pubien)
- Dysurie (douleur ou inconfort lorsque l’on urine)
- Douleur au niveau de l’urètre
- Particules blanches ou mucus dans l’urine
- Difficultés à uriner
- Pertes vaginales
- Pus découlant des glandes de Skene (différent de l’éjaculat féminin)
- Dyspareunie (douleur pendant ou après les rapports sexuels)
- Sensibilité ciblée autour des glandes de Skene
- Une petite bosse que l’on peut sentir en passant le doigt dessus (cela peut être un kyste des glandes de Skene ou, si c’est dans une zone différentes, une masse génitale)
Si le jet urinaire est toujours dévié dans la même direction ou s’il vous est difficile d’uriner, vous avez peut-être un kyste au niveau des glandes de Skene. Celui-ci risque d’exercer une pression sur votre urètre ou même de le bloquer.
La skénite peut-elle provoquer des infections urinaires à répétition ?
Comme les glandes de Skene et l’orifice de l’urètre sont très proches, la skénite et les infections urinaires vont souvent ensemble, puisqu’une infection peut facilement se propager d’une zone à l’autre. Après tout, les bactéries ne restent pas toujours là où elles ont se sont formées, surtout dans la région urogénitale.
Une infection des glandes de Skene peut servir de réservoir pour les bactéries, où elles restent plus ou moins protégées pendant la durée d’un traitement contre une infection urinaire. Une fois que le traitement est fini, les bactéries peuvent à nouveau envahir le système urinaire en partant des glandes de Skene. Le cycle se remet alors en marche.
Pour compliquer encore les choses, beaucoup de symptômes provenant de la skénite ou d’une infection urinaire sont interchangeables, à l’exception de la bosse d’un kyste potentiel ou l’écoulement d’un abcès. Même la sensibilité aiguë ressentie dans la zone pourrait être prise pour une irritation de l’urètre.
Par conséquent, la skénite est souvent prise pour une infection urinaire ou tout simplement ignorée, de la même façon que les infections urinaires récurrentes ne sont souvent pas diagnostiquées. Puisque de nombreux antibiotiques permettent de traiter la skénite, sans même qu’elle n’ait été identifiée, plusieurs chercheurs croient désormais que cette maladie est bien plus commune que ce que l’on pouvait s’imaginer.
Quels sont les organismes qui causent une skénite ?
Il existe plusieurs organismes différents capables d’infecter les glandes de Skene. Comme mentionné plus haut, la skénite est souvent provoquée par l’un des organismes suivants :
- La gonorrhée, une infection sexuellement transmissible que l’on retrouve avant tout dans le vagin
- La bactérie e.coli, présente dans les intestins et les matières fécales d’une personne en bonne santé et chez les animaux. Mais, elle peut migrer jusqu’à l’appareil urinaire, causant alors une infection
- La flore vaginale, c’est-à-dire l’ensemble des organismes peuplant l’intérieur du vagin
Il faut savoir que les bactéries à l’origine de la skénite peuvent être détectées grâce à une culture d’urine si l’échantillon contient les toutes premières gouttes du jet urinaire. La plupart du temps, les indications des ECBU demandent un échantillon d’urine à mi-jet. Ces premières gouttes sont donc rarement prises en compte.
Au début de la miction, les bactéries vivant sur la peau sont immédiatement éliminées. L’urine a donc moins de risques d’être contaminée par ces bactéries si l’échantillon est prélevé à mi- jet. Mais dans le cas de la skénite, ce processus risque de faire disparaître toutes les preuves.
Skénite et syndrome urétral
Le syndrome urétral ou sténose urétrale fait référence à une série de symptômes pour lesquels on ne parvient pas à déterminer de cause (ex. : une infection bactérienne). La skénite est l’équivalent féminin qui se rapproche le plus de la prostatite et pourtant, comme mentionné plus haut, elle est rarement diagnostiquée.
Le syndrome urétral est donc souvent considéré de manière informelle comme l’équivalent féminin de la prostatite masculine, car ils ont des symptômes en commun. Cependant, ils sont très différents sur le plan anatomique.
Il est intéressant de noter qu’environ la moitié des hommes passent par une prostatite dans leur vie. Un traitement antibiotique se montre efficace uniquement dans 35% des cas de prostatites chroniques.
Cela signifie que les symptômes urinaires tels que la fréquence urinaire, l’urgence et les douleurs au moment d’uriner, couplées avec des douleurs pelviennes et dans le bas du dos affectent massivement les hommes comme les femmes. Mais les causes de ces symptômes diffèrent.
Le syndrome urétral et la cystite interstitielle sont tous les deux des diagnostics d’élimination. Un diagnostic d’élimination est posé quand on repère une série de symptômes spécifiques mais pas leur origine, et les facteurs les plus courants ont déjà été écartés.
Le syndrome urétral et la cystite interstitielle ont beaucoup de symptômes en commun, la seule différence clinique étant la cystite (inflammation de la vessie).
Les symptômes du syndrome urétral sont les suivants :
- Nycturie (besoin fréquent d’aller aux toilettes, surtout la nuit)
- Fréquence urinaire (miction fréquente, à tout moment)
- Urgence (le besoin souvent soudain et parfois incontrôlable d’uriner, même s’il n’y a pas ou peu d’urine dans la vessie)
- Incontinence par impériosité (quand le besoin d’uriner est si pressant que vous ne pouvez pas vous retenir et vous relâchez une petite ou grande quantité d’urine avant d’arriver aux toilettes)
- Dysurie (douleur pendant la miction)
- Douleurs dans le bas du dos, dans le bas du ventre et/ou dans la région génitale
- Dyspareunie (douleur pendant ou après les rapports sexuels)
- Hématurie microscopique (une quantité minuscule de sang dans votre urine)
- Hématurie terminale ou initiale (l’apparition de sang uniquement à la fin ou au début de votre jet urinaire)
- Pertes urinaires post-miction (quand une petite quantité d’urine s’écoule après un passage aux toilettes)
- Retard de la miction (difficulté à commencer à uriner)
- Sensation de ne pas pouvoir vider entièrement votre vessie
- Flux urinaire interrompu (quand votre jet urinaire démarre puis s’arrête plusieurs fois de manière incontrôlée)
Le syndrome urétral est-il causé par une infection ?
Vous pourrez constater qu’un grand nombre de symptômes cités ci-dessus sont associés aux infections urinaires récurrentes. Mais ils sont aussi désignés comme les symptômes d’une cystite interstitielle.
Comme mentionné précédemment, il n’y a qu’un symptôme qui ne soit pas présent dans la liste du syndrome urétral et que l’on retrouve dans le cas des infections urinaires et des cystites interstitielles. Il s’agit de la cystite, ou l’inflammation de la vessie.
La cystite n’est pas associée au syndrome urétral, certains chercheurs avancent donc que la grande majorité des cas de syndrome urétral sont en réalité des skénites.
Toutefois, comme les médecins ne pratiquent généralement pas d’examen physique des glandes de Skene via le vagin, la sensibilité aiguë et le mucus possiblement dû à une infection sont rarement détectés.
Si on vous a déjà diagnostiqué un syndrome urétral ou si vous avez souvent des symptômes qui y correspondent, vous devriez peut-être prendre le temps de demander à votre médecin de procéder à un examen manuel. Ainsi, il pourrait repérer une éventuelle skénite. Le syndrome urétral pourrait être dû à une infection et les injections antimicrobiennes directes peuvent être une solution.
La skénite et les infections urinaires récurrentes ne sont pas les seules maladies qui entraînent ces symptômes. C’est pourquoi nous avons également traité les 5 causes les plus communes dans notre article sur les symptômes d’infections urinaires. Nous y avons également évoqué les quelques possibilités moins courantes.
Il faut garder à l’esprit qu’une des causes non bactérienne d’un syndrome urétral peut être une réaction proche de l’allergie, se manifestant sous la forme d’une inflammation dans la zone urétrale. Dans une telle situation, il est possible d’apaiser les symptômes grâce à un régime restreint (ne contenant généralement pas de caféine ni d’alcool ou de nourriture épicée) et des antihistaminiques.
Skénite et vulvodynie
La skénite peut parfois déclencher une vulvodynie. La vulvodynie correspond à une douleur ou une gêne parfois accompagnée d’une inflammation de la vulve (les parties génitales externes sur l’extérieur du vagin) sur une durée de plus de 3 mois.
Tout comme la cystite interstitielle ou le syndrome urétral, la vulvodynie est un diagnostic d’élimination. Selon certaines études, 16% des femmes passent par une vulvodynie dans leur vie.
Les symptômes de la vulvodynie comprennent aussi des sensations de brûlure, de piqûre, d’écorchure, ainsi que des démangeaisons, irritations ou une grande sensibilité. Ceux-ci peuvent se manifester n’importe où dans la zone vulvaire. Ces symptômes se manifestent parfois, pas toujours, en réponse à un contact physique (par exemple pendant un rapport sexuel ou à l’emploi d’un tampon).
Pour certaines personnes les symptômes ne se manifestent qu’à certains moments, comme juste avant les règles ou après un rapport. Pour d’autres, les symptômes sont constamment présents, indépendamment des facteurs extérieurs.
De plus, chaque personne souffre différemment de la vulvodynie . La fréquence, l’intensité et la récurrence des épisodes varient.
Comme pour les symptômes d’infection urinaire, la vulvodynie peut avoir un fort impact sur la qualité de vie en général. L’humeur, le stress, l’estime de soi, le rapport au sexe et au plaisir, les relations amoureuses, la possibilité de pratiquer des activités physiques ou sociales ; toutes ces choses peuvent être affectées.
La vulvodynie et la cystite interstitielle sont souvent comorbides (elles ont lieu en même temps). Des études affirment qu’environ un quart des personnes souffrant de cystite interstitielle ont aussi une vulvodynie.
Pas besoin de diagnostics officiels attestant de troubles du système urinaire pour affirmer ceci : beaucoup de personnes souffrant de vulvodynie ressentent aussi des symptômes d’infection urinaire. Ceux-ci comprennent une sensation de pression ou des douleurs au niveau de la vessie, une fréquence et une urgence urinaire. De plus, si une personne souffre de dysurie, (douleur au moment d’uriner) elle a plus de risques de contracter une vulvodynie.
Quelles sont les causes d’une vulvodynie ? En quoi la cystite interstitielle est-elle impliquée ?
On pense que la vulvodynie et la cystite interstitielle partagent certains facteurs étiologiques (des causes). Tout d’abord, on retrouve une hyperactivité des mastocytes dans les deux cas. Les mastocytes sont des globules blancs qui agissent en tant que « premiers intervenants » contre les infections. Ce sont eux qui déclenchent les inflammations.
En plus de jouer un rôle dans les troubles chroniques comme la maladie de Crohn et la sclérose en plaques, les mastocytes sont responsables des réactions allergiques. Les mastocytes libèrent de l’histamine. On a découvert que celle-ci accroît la sensibilité à la douleur chez les personnes souffrant de vulvodynie.
Aujourd’hui, on en sait peu sur l’implication potentielle des mastocytes hyperactifs dans la vulvodynie et les troubles de la vessie.
Ensuite, la vulvodynie et la cystite interstitielle (et potentiellement le syndrome urétral) sont enclenchés par une douleur neuropathique. Les nerfs qui desservent la zone touchée sont stimulés à un seuil plus bas que la normale.
Ce nerf défectueux peut, mais pas toujours, être le résultat à long terme d’une blessure ou infection (déjà « guérie ») d’une certaine zone, parfois aggravé par une inflammation. Cela peut être le cas pour une skénite. Chez l’anatomie féminine, les systèmes reproductifs et urinaires ont beaucoup de voies neurales en commun.
Enfin, les symptômes de la vulvodynie et de la cystite interstitielle peuvent varier selon les fluctuations hormonales, comme celles qui ont lieu juste avant les règles.
Il faudrait faire plus de recherches sur le possible lien entre la vulvodynie, la cystite interstitielle et la skénite. Toutefois, il y a une logique à penser que ces maladies pourraient potentiellement être liées de plusieurs façons.
Comme mentionné précédemment, la vulvodynie est parfois déclenchée par une infection menant ensuite à un dysfonctionnement nerveux. En plus de cela, la sensibilité aiguë et l’inflammation causées par la skénite pourraient en théorie être prises pour une vulvodynie.
Si l’on vous diagnostique une vulvodynie mais que vous pensez avoir une skénite, vous devriez en discuter avec votre médecin.
Comment la skénite est-elle diagnostiquée ?
Un examen pelvien rigoureux comprend une palpation de la paroi vaginale antérieure (le devant), là où les glandes de Skene sont situées. Cet examen permet la découverte d’une skénite, si l’on repère un écoulement depuis l’abcès ou si l’on ressent la présence d’un kyste.
Pourtant, si votre médecin croit que vous avez une infection urinaire, vous risquez de ne pas avoir accès à un examen pelvien. A la place, on vous demandera peut-être simplement un échantillon d’urine.
Même s’il existe une chance pour que les bactéries issues des glandes de Skene infectées se retrouvent dans l’échantillon d’urine, les ECBU ne sont pas des méthodes fiables pour repérer les skénites. De plus, aucun test standard ne permet de détecter la présence de bactéries dans l’éjaculat féminin.
Si vous pensez avoir une skénite, vous devriez peut-être en parler à votre médecin, ou à un urologue/urogynécologue qui a déjà traité des skénites. Vous pouvez lui demander de procéder à un examen de vos glandes de Skene.
Traitement de la skénite
Comme expliqué ci-dessus, il arrive que certains cas de skénite bactérienne ne soient diagnostiqués à tort comme des infections urinaires et réagissent pourtant de manière positive aux antibiotiques oraux prescrits.
Pourtant, pour qu’un antibiotique agisse sur une infection bactérienne présente dans les glandes de Skene, il faut qu’il puisse pénétrer les tissus. C’est pourquoi de nombreux antibiotiques prescrits en cas d’infections urinaires ne seront pas efficaces dans le traitement de la skénite. Ils ne pénètrent pas les tissus glandulaires, à la place, ils agissent uniquement dans l’urine.
Le traitement de la skénite requiert souvent de rester sous antibiotiques plus longtemps que pour une infection urinaire non compliquée. La durée peut aller de 4 à 6 semaines. Cette méthodologie des traitements antibiotiques se rapproche plus de celle de la prostatite que de celle des infections urinaires.
Les symptômes de la skénite aiguë peuvent être apaisés en appliquant des compresses humides et bien chaudes et en prenant des bains de siège.
Le traitement du kyste aux glandes de Skene
Un kyste ou un abcès aux glandes de Skene est typiquement soigné par la prise d’antibiotiques oraux. Si cela ne suffit pas, il faudra peut-être procéder à une intervention chirurgicale.
L’abcès peut être drainé par une aspiration à l’aiguille ou en faisant une petite incision au niveau de l’orifice de la glande, si possible en cautérisant les bords, pour permettre un écoulement continu. Ce genre de procédure se fait généralement sous anesthésie locale.
Si les abcès ou les kystes aux glandes de Skene sont récurrents, le risque de développer une tumeur maligne augmente. Dans ce cas, on peut envisager une ablation des glandes de Skene.
Trouver l’aide adéquat pour venir à bout du symptôme urétral
La skénite, comme tout autre le trouble urinaire, peut avoir un effet très négatif sur la santé mentale. La douleur aiguë et la gêne causée par les symptômes physiques ne sont pas les seuls problèmes. Ce trouble peut mener à la dépression, déclencher de l’anxiété, dégrader la confiance en soi, limiter les activités physiques et sociales auxquelles vous aimez participer, affecter votre vie sexuelle et également votre vie romantique.
Si vous vous sentez psychologiquement dépassé·e par la skénite chronique ou récurrente, vous pouvez vous faire appel à un·e psychologue. En parallèle, nous vous conseillons notre série d’interviews vidéo avec la Dr. Sula Windgassen, psychologue habituée aux patients souffrant d’infections urinaires à répétition.
Vous pourrez également trouver de l’aide dans dans groupes de soutien sur Facebook. Vous avez la possibilité de vous renseigner auprès d’autres personnes qui ont déjà eu une skénite afin de trouver un spécialiste qui pourrait vous aider.
Les chirurgien·nes qui participent à la recherche sont souvent celles et ceux qui traitent les patients. Donc chercher des articles au sujet de la skénite dans votre moteur de recherche peut aussi vous permettre de trouver des réponses.
Trouvez des réponses aux questions qui nous sont fréquemment posées sur les infections urinaires récurrentes et chroniques sur notre page FAQ.
Partagez-nous vos questions et commentaires ci-dessous, ou contactez notre équipe.